Accueil > Veille masterisation/ concours > Analyses > L’IUFM et ses fantômes. Entre critique radicale, évaluation experte et (...)
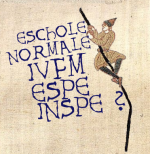 L’IUFM et ses fantômes. Entre critique radicale, évaluation experte et politique libérale - Michel Fabre, université de Nantes, CREN, 4 septembre 2009
L’IUFM et ses fantômes. Entre critique radicale, évaluation experte et politique libérale - Michel Fabre, université de Nantes, CREN, 4 septembre 2009
mardi 15 septembre 2009, par
Ce texte a été présenté dans un symposium du colloque "Les enjeux épistémologiques et politiques des
sciences de l’éducation : quelle implication des acteurs ?" du CERFEE-LIRDEF de Montpellier le 4 septembre
2009. Il sera publié dans les Actes en ligne de ce colloque et peut être librement reproduit avec mention du nom
d’auteur et du colloque de Montpellier (intitulé complet).
Cette réflexion naît d’un étonnement devant les contradictions des récentes réformes de la formation des
maîtres. Comment expliquer ces tensions entre la volonté plus ou moins explicite d’en finir avec les IUFM et
celle d’encadrer des futurs masters de l’éducation par une charte exigeante sur le plan de la formation
professionnelle ?
Il semble que les politiques hostiles aux IUFM aient souvent hésité entre une attaque frontale exigeant leur
élimination pure et simple et une stratégie plus oblique suggérant leur dissolution dans l’Université, laquelle
serait susceptible de réaliser « un contrôle par absorption », pour reprendre les termes du rapport du Sénateur
Adrien Gouteyron de 1992. On se souvient qu’en 1993 le ministre Fillon, alors en charge de l’éducation
nationale, déclarait que le procès des IUFM n’était plus à faire et que par conséquent, leur « logique » devait
être supprimée. Si l’année 1993 fut effectivement « celle de tous les dangers », François Fillon décida
finalement de réformer et non de supprimer les IUFM (Robert et Terral, 2000, p.110). L’attaque frontale ayant
échoué, sans doute par manque de solution de remplacement, restait l’autre voie proposée dès 1992 par le
rapport Gouteyron et l’académie des sciences : la suppression par dissolution dans l’Université. Le nouveau
ministère Fillon de 2005 allait s’y employer en mettant au point la stratégie à double détente imaginée par le
conseiller Marc Sherringham (ex directeur de l’IUFM d’Alsace : 1) intégration à l’Université (2005) ; 2)
mastérisation des formations (2009). Paraissant redorer le blason de la formation des maîtres tout en
fournissant la caution universitaire aux lobbies hostiles à l’IUFM, cette stratégie rusée entendait désarmer les
critiques de tous bords
Mais comment expliquer alors l’insistance avec laquelle la circulaire du 17 Octobre 2008, encadrant les futurs
masters « métiers de l’éducation » reprend les recommandations du Haut Conseil de l’Education [1] en vue
d’une véritable formation professionnelle des enseignants ? Le texte met d’ailleurs en annexe l’arrêté du 19
décembre 2006 définissant le référentiel des compétences professionnelles des maitres. Or ce référentiel
n’est autre que celui qui encadrait la formation des maîtres à l’IUFM ! Faut-il ne voir dans la circulaire de 2008
qu’une hypocrisie diplomatique, ou encore la manifestation d’une lutte de pouvoir entre ministères ? Est-ce le
signe que les chances d’une véritable formation des maîtres ne sont pas définitivement perdues en dépit des
bouleversements structurels qu’impose la loi ? L’IUFM liquidé, son fantôme ne hanterait-il pas les couloirs de
l’Université ? A moins que ces contradictions ne soient finalement balayées par la vague libérale dont les
attendus se situent tout à fait ailleurs. Pour y voir clair, il importe de confronter deux types de discours
éducatifs entre lesquels semblent hésiter les politiques : le discours bruyant et médiatisé de la critique radicale
et le discours réformiste, beaucoup plus discret des rapports d’expertise.
I. Le discours de la critique radicale
Le discours radical anti-IUFM rassemble deux sortes de critiques venues d’horizons différents : le discours
idéologique des intellectuels et l’expérience vécue des stagiaires.
Le discours des intellectuels
Le débat public sur l’école a été réactivé en France par l’essai de Milner De l’Ecole (1984) et la réponse
d’Antoine Prost Eloge des pédagogues (1985). Ce débat oppose majoritairement des « néo-républicains » et
des « pédagogues ». Mais si certains discours lient explicitement la question de l’école à celle de la
République, d’autres s’instaurent plutôt en défenseurs de la Culture contre la « barbarie ». Quoi qu’il en soit,
ces débats héritent de thèmes qui ont reçu une première élaboration à la Révolution Française et qui ont été
repris lors de l’institution de l’école laïque, sous Jules Ferry, puis dans la philosophie du radicalisme d’Alain. Ils
rappellent également les controverses des années trente aux USA autour de la « progressive education »
renouvelées par Hannah Arendt, dans les années soixante, avec La crise de la culture. La controverse repose
sur un certain nombre de dualismes « théologiques » (comme dirait François Dubet) dont la plupart étaient
déjà dénoncés chez Dewey : clôture ou ouverture de l’école sur la vie, instruction ou éducation, savoir ou
pédagogie, mise entre parenthèses ou prise en compte des différences, intérêt et effort, centration sur l’enfant
ou sur les programmes (Solère-Queval 1999). Le débat piétine même, s’il alimente une littérature
pamphlétaire et caricaturale abondante et toujours renouvelée (Fabre, 2002).
Si ces “ lieux communs” de la pensée pédagogique constituent l’investissement idéologique de fond, le débat
s’alimente à l’histoire scolaire récente de la démocratisation de l’enseignement. C’est particulièrement la loi
Jospin de 1989 qui est visée. Pour la critique radicale, mettre l’élève au centre du système scolaire
marginalise l’importance du savoir disciplinaire et partant, le rôle du maître. Le rapport annexé à la Loi
d’Orientation, puis le rapport Bancel, définissent en effet le profil du maître à venir qui ne devra plus se
contenter de maîtriser la discipline mais « de connaître les processus d’acquisition des connaissances, les méthodes
de travail en groupe, les méthodes d’évaluation, le système éducatif et son environnement. » (Robert et Terral 2000,
p. 60). D’où un front de refus largement médiatisée contre cette conception professionnalisée du métier
d’enseignant, signifiant pour beaucoup « la fin des professeurs » [2] .
L’attaque contre l’IUFM s’alimente ici à une critique radicale de l’école et même parfois de la culture, comme
chez Hannah Arendt. S’agissant précisément de la formation des maîtres, c’est l’optique de la
professionnalisation qui est visée, parce qu’elle met à mal le modèle de « l’homme cultivé », voire de
« l’intellectuel critique » auxquels s’identifient traditionnellement les professeurs du secondaire (Bourdoncle,
1990). Au fond, ce que la critique radicale ne peut imaginer, c’est la nécessité, pour les futurs enseignants,
d’une reconversion professionnelle qui doit faire de l’étudiant historien ou philosophe, passionné par sa
discipline, un professeur d’histoire ou de philosophie, c’est-à-dire, dans le nouveau modèle de professionnalité
de l’IUFM, un « gestionnaire de l’apprentissage » de ces disciplines. Pour les néo-républicains et les gardiens
du temple de la Culture, cette reconversion s’apparente à une nouvelle « trahison des clercs ». Et comme elle
s’avère difficile, la critique radicale est toujours à l’affut des dérives qu’elle ne manque pas de susciter et qui
sont interprétées alors comme des symptômes d’un mouvement pervers (voire d’un complot) de
technicisation, de bureaucratisation, de manipulation idéologique, conduisant du même coup à l’infantilisation
des futurs enseignants.
La critique des stagiaires
Le deuxième type de critique radicale émane de stagiaires IUFM ou de jeunes enseignants. Nous nous
intéressons ici, non pas aux enquêtes qui visent à rendre compte – le plus objectivement possible – des
opinions des stagiaires, mais aux témoignages spontanés, sollicités ou récupérés par la critique intellectuelle.
A travers la prolifération d’anecdotes plus croustillantes les unes que les autres, surgissent quelques thèmes récurrents [3]
.
C’est d’abord l’infantilisation qui est dénoncée. L’obligation de présence au cours, l’évaluation délicate de
certains aspects de la formation (en particulier les formations générales et communes), un certain
« chantage » à la certification sont particulièrement visés. Bref, l’IUFM ne permettrait pas, malgré ses
intentions affichées, le développement d’une véritable autonomie professionnelle
Les agrégés stagiaires à l’IUFM. Résultats et analyse de l’enquête effectuée auprès de nos sociétaires, agrégés stagiaires en 2006-2007.
Société des Agrégés de l’Université – 2007.
. Un autre thème qui revient
sans cesse est la coupure théorie / pratique. Les enseignements visant la formation professionnelle seraient
trop théoriques, jargonnants, appuyés sur de pseudo-sciences (les sciences de l’éducation) et sans rapport
avec la pratique. En revanche, le stage sur le terrain et le rôle des tuteurs sont la plupart du temps plébiscités.
Quant aux dispositifs d’alternance (analyse des pratiques et autres) ils sont souvent critiqués comme
verbeux
[4]. Le faible niveau scientifique des enseignements est également souvent épinglé, surtout par les
agrégés qui comparent les cours d’IUFM aux cours qu’ils avaient à l’Université. C’est bien entendu les
formations générales et communes qui se voient les plus contestées [5]. Enfin, on déplore également le fait que
tous les enseignants, aussi bien du primaire que du secondaire, soient regroupés dans une même structure et
subissent une formation commune (quand toutefois elle existe encore !) faisant fi des spécificités de chaque
niveau d’enseignement. Bref, l’IUFM serait « inefficace, inutile et parasitaire ».
Naturellement, ces témoignages et ces enquêtes devraient être maniés avec précautions et rapportés aux
travaux sociologiques qui, sans nier les difficultés de la formation, en donnent une vision beaucoup moins
négative [6] . Surtout, ils devraient être discutés en prenant en compte les phénomènes bien connus qui
caractérisent l’évaluation de leur formation par les enseignants débutants. Les travaux déjà anciens
d’Huberman (1989) montrent bien qu’on ne peut interpréter les jugements que portent les enseignants sur leur
formation sans prendre en compte les préoccupations qui sont les leurs à cette étape de leur carrière
[7]
. On ne
peut certes négliger la lettre de ce qui est dit, mais on doit pouvoir la mettre en perspective par rapport aux
préoccupations des stagiaires, en passe d’exercer un métier difficile, éprouvant souvent l’angoisse de la
première classe et dont l’identité s’avère problématique puisqu’ils ne sont plus tout à fait étudiants, mais pas
encore collègues. Dans de telles conditions, et sans méconnaître du tout les difficultés de la formation des
maîtres, ni même ses éventuelles dérives, il faut bien reconnaître qu’il serait surprenant que les stagiaires se
disent suffisamment préparés à exercer leur métier. On verra bien d’ailleurs ce qu’ils diront de leurs nouvelles
formations à l’Université ! La critique radicale s’empare néanmoins de ces témoignages et de ses résultats
d’enquête, sans aucune précaution méthodologique, car ils viennent donner chair à l’argumentation
proprement idéologique.
II. Le discours « réformiste »
Si la critique radicale s’avère très médiatisée, le discours réformiste des rapports d’évaluation des IUFM est
beaucoup moins connu. Les lois du genre le distinguent nettement du discours radical. Ces textes se
caractérisent par le sérieux de l’évaluation. Classiquement, les rapports distinguent une description précise du
contexte historique, un état des lieux et des recommandations. Les évaluations sont fondées sur des
enquêtes, sur des interviews d’experts, sur des analyses de témoignages. La méthodologie est la plus part du
temps précisée. D’autre part, les rapports ne se contentent pas d’une appréciation globale et lointaine mais
entrent dans le détail de manière très précise : administration de l’IUFM, formation, recrutement, concours….
Enfin ces rapports sont généralement le fruit d’une élaboration et d’une discussion collective d’évaluateurs
d’horizon souvent différents : universitaires, administrateurs, inspecteurs généraux, homme politiques
[8]
.
Quelle image de l’IUFM ressort de ces rapports ?
Dans l’ensemble des textes consultés, l’existence de l’IUFM n’est que très rarement remise en question. On a
déjà signalé le rapport Gouteyron qui proposait en 1992 la dissolution de l’IUFM dans l’Université. Mais même
le rapport Kaspi de 1993, très critique, commence par affirmer qu’il n’est pas question de supprimer les IUFM
mais de les réformer (déjà !) Tous les observateurs notent d’ailleurs que le ton des évaluations change lorsque
l’institution se stabilise après 1993 « l’année de tous les dangers ». Si bien que le grand rapport du CNE de
2001 qui évalue en détail 22 IUFM sur 27 conclut sur une image globalement positive
[9] . Il en est de même
pour le rapport Bornancin de 2001 ou le rapport Septours de 2003.
Les critiques dénoncent souvent les mauvaises conditions qui rendent difficiles le travail de l’IUFM. Le Rapport
du CNE de 2001, comme le rapport Septours de 2003, insistent sur ce qui fait le plus défaut de la part de l’état
: « un message fort sur le métier d’enseignant ». Les critiques portent également sur la nature et la place des
concours qui ne favorisent pas la professionnalité enseignante ; sur la politique de recrutement qui n’anticipe
pas assez les besoins, ce qui favorise l’embauche de trop d’auxiliaires difficiles à former correctement.
Beaucoup de ces critiques relayent ainsi celles des personnels de l’IUFM et des syndicats d’enseignants. Le
rapport Septours (2003) préconise par exemple de mettre le concours immédiatement après la licence et de
porter la formation professionnelle à deux ans, tout en mettant en avant le surcoût de l’opération ! [10] .
Les critiques concernant directement la formation IUFM ne remettent pas en question l’esprit de l’institution
mais mesurent plutôt l’écart entre les missions données à l’IUFM et les résultats. Excepté le rapport Kaspi, qui
contient en substance la matrice des critiques dont s’emparera le discours idéologique anti-UFM
[11] , les
rapports se situent en effet dans l’axe de la professionnalisation de la formation des maîtres. Et s’ils critiquent
les IUFM, parfois avec quelque sévérité, c’est parce qu’ils ne réalisent imparfaitement les missions qui leur
sont attribuées. Ainsi le rapport du CNE de 2001 préconise-t-il de renforcer le caractère à la fois professionnel
et universitaire de la formation des maîtres ; de développer l’alternance théorie pratique et d’associer plus
étroitement les formateurs au terrain scolaire et à la vie universitaire. Il se félicite que le mémoire
professionnel, si contesté lors de la mise en place de l’IUFM, soit à présent accepté et perçu plus positivement
par les formateurs et les formés comme un outil indispensable à la réflexion sur les pratiques. Le rapport
Bornancin (2001) tient à ce que ce mémoire devienne véritablement « le versant intellectuel et réflexif de la
formation ». Le rapport Septours préconise des modifications structurelles (allongement du temps, réforme
des concours et des conditions de recrutement) pour renforcer la professionnalisation de la formation. On ne
s’étonnera pas que les principales cibles des rapports soient la formation commune et la formation générale
inexistante ou peu consistante. Mais là encore, il ne s’agit aucunement de les remettre en question. Les
critiques, tout en reconnaissant les difficultés de l’entreprise, visent seulement l’insuffisance des résultats.
Non seulement les experts ne remettent pas en question l’existence des IUFM mais ils s’efforcent de se
distancier du discours idéologique qui leur est hostile. C’est le cas particulièrement pour le CNE (2001) qui
affirme vouloir boucler son rapport prématurément, même si quelques IUFM n’ont pu encore être évalués, et
ceci pour intervenir dans le débat public : « Le CNE ne peut donc pas valider le bien-fondé d’un certain nombre de
procès faits aux IUFM – « pensée pédagogique unique », « emprise des sciences de l’éducation », « mépris pour les
savoirs disciplinaires » – ou de certaines généralisations hâtives à partir de tel ou tel incident, de tel ou tel témoignage,
de telle ou telle statistique, ou de tel ou tel article de presse ». En réalité, poursuit le CNE, le débat idéologique
masque les vrais problèmes qui se posent aux IUFM et que le rapport s’efforce d’analyser. Si la critique vise
particulièrement les campagnes médiatiques anti-IUFM, le CNE s’intéresse également aux doléances des
stagiaires. Il est intéressant de constater que les évaluateurs se montrent extrêmement prudents en la matière
et effectuent une véritable critique de témoignage
[12] . Ces précautions méthodologiques contribuent à relativiser
certaines plaintes récurrentes concernant par exemple le caractère inadéquat, trop théorique, des
enseignements IUFM. Ce genre de critique – dit le rapport du CNE - relève bien souvent d’un malentendu : les
stagiaires sont pris dans l’angoisse de la première classe et cherchent des recettes qu’ils trouvent ou non
chez leurs tuteurs alors que les formateurs « et c’est leur tâche, s’emploient davantage à faire acquérir, par les
stagiaires, des repères et des outils conceptuels qui leur permettent d’analyser les problèmes et de les mettre en
situation de trouver eux-mêmes des réponses adaptées au contexte dans lequel ils se posent. »
[13]
.
Cette connaissance du contexte spécifique de la formation et la relativisation des critiques qu’elle induit,
n’empêche pas le CNE de prendre très au sérieux : « le sentiment d’infantilisation qu’expriment souvent les
étudiants et, ce qui est peut-être plus inquiétant, les professeurs stagiaires ». En effet, ce que l’évaluation met en
évidence, c’est l’écart entre l’affichage d’une « formation d’adulte » fondée sur « l’autonomie et la
responsabilité des formés »… et la réalité des pratiques de formation. Il est vrai que cet écart est dû en partie
au fait que les formés ont du mal à se construire une identité qui n’est plus celle d’étudiants et qui n’est pas
encore celle de « collègue ». Comme l’indique bien le rapport Septours, la formation se fait en France en
mode successif (4 ans d’Université + 1 an de formation professionnelle). Or ce mode successif souligne
insuffisamment la rupture qui devrait exister entre formation académique et formation professionnelle et la
reconversion qu’une telle rupture nécessite
[14].
La connaissance précise des contextes de la formation ainsi que des difficultés spécifiques qui lui sont liées
permet donc aux rapporteurs de relativiser les critiques portées aux IUFM, tout en soulignant les progrès à
réaliser en direction d’une véritable formation professionnelle, sur laquelle, selon le rapport Septours, « il ne
faut pas transiger ». Elle permet également – et le rapport Septours insiste sur ce point - de désamorcer les
dualismes paralysants qui constituent - on l’a vu plus haut - les ressorts des machines de guerre idéologiques
anti-IUFM : l’opposition de la théorie et de la pratique, de la formation disciplinaire et de la formation
professionnelle, de la formation initiale et continue, commune et spécialisée.
III. 2009 nouvelle « année de tous les dangers » ?
Si l’année 2009 apparaît, pour l’IUFM, comme une nouvelle « année de tous les dangers », à l’instar de 1993,
c’est bien parce que le pouvoir politique paraît hésiter – une nouvelle fois - entre le discours radical des idéologues et le discours réformiste des experts. Mais les deux situations sont-elles superposables ? En
réalité un certain nombre d’éléments conjoncturels viennent compliquer ce que Philippe Meirieu appelle
« l’ambiguïté constitutive des IUFM »
[15]
.
L’ambiguïté constitutive des IUFM
L’IUFM est une jeune institution de 20 ans (ce qui est peu comparé à la longévité bi-centenaire de l’Ecole
Normale), issue d’une gestation difficile, contestée dés sa naissance et menacée d’une mort prématurée. Ce
destin peu enviable s’explique par une fragilité initiale et jamais enrayée.
D’un côté les syndicats du premier degré appelaient à la création d’un corps unique d’enseignants et à la
revalorisation de la formation : d’où par exemple un recrutement de tous au niveau licence. Selon le principe
finement analysé par Antoine Prost, de « l’attraction par la filière la plus prestigieuse », la formation des
enseignants allait donc subir l’influence du mode de formation universitaire des enseignants du second degré
au détriment de celui développé dans les EN ou les ENNA. Mais d’un autre côté, la prise en compte des
nouvelles situations d’enseignement et celle des caractéristiques du public scolaire issu de la démocratisation,
semblaient requérir la transposition à la formation des enseignants du second degré des modèles
pédagogiques venus du primaire et véhiculés par feu les Ecoles Normales. D’où une logique de compromis : il
fallait rassurer les tenants de la culture et des savoirs en garantissant la teneur disciplinaire des concours.
Mais d’autre part, il fallait bien faire quelques concessions à la culture primaire : d’où la création des
formations générales et communes, l’instauration de l’analyse des pratiques, du mémoire professionnel, de
l’épreuve professionnelle des concours. C’est de ces compromis, parfois douteux, qu’est né l’IUFM. C’est à
eux qu’il doit d’avoir survécu tant bien que mal jusqu’ici, non sans tiraillements.
C’est pourquoi Philippe Meirieu a raison de dire que nous ne faisons aujourd’hui « qu’expier ce compromis
initial » dans une sorte de « bégaiement constitutif », qui prend la forme d’une « négociation sans fin livrant
l’institution aux aléas des événements et des rapports de forces du moment ».
[16]
C’est que l’IUFM ambitionnait
d’en finir avec le clivage historique du primaire et du secondaire. Ce qui impliquait, pour les acteurs
concernés, une sorte de révolution culturelle. En effet l’instauration de l’IUFM venait bousculer les images que
les différents acteurs se faisaient de leur métier. Il est vrai que le modèle « charismatique » des enseignants
du primaire (Bourdoncle, 1990) avait déjà été mis à mal dans l’évolution des Ecoles Normales. La vague
psycho-pédagogique, celle de la Vidéo formation, puis la généralisation de l’analyse des pratiques ainsi que la
rénovation des démarches didactiques avaient favorisé progressivement, au-delà des ruptures et des
changements de paradigmes, l’avènement d’un mode de professionnalité enseignante aboutissant au modèle
du praticien réflexif. Les choses ont sans doute évolué plus lentement dans le second degré (à l’exception de
l’enseignement technique, en raison des ENNA), malgré le travail des MAFPEN, des IREM et de l’INRP. C’est
pourquoi, la critique radicale, même s’il lui arrive quelquefois de mobiliser la figure charismatique de
l’instituteur de la troisième république, s’autorise le plus souvent des modèles traditionnels de l’enseignant
secondaire, celui de « l’homme cultivé » ou de « l’intellectuel critique », dans sa résistance aux dynamiques
de professionnalisation.
Cette ambiguïté constitutive de l’IUFM s’exprime bien dans les attendus de la critique radicale et l’opposition
qu’elle suscite entre savoir et pédagogie. L’idée de la critique radicale est, pour l’essentiel, que le savoir
disciplinaire, joint à quelques recettes éprouvées reçues d’enseignants chevronnés, suffit pour enseigner.
D’où le mépris de la pédagogie et du pédagogique, cette véritable « bizarrerie nationale » que dénonçait déjà
Durkheim au début du XXème siècle dans l’Evolution pédagogique en France [17]
. On ne peut cependant
comprendre ce mépris sans lui donner une coloration sociologique, celle même que repérait Vivianne
Isambert Jamati quand elle évoquait les propos des professeurs du secondaire traitant les instituteurs
« d’incapables prétentieux ». La pédagogie est bonne en rigueur pour les instituteurs, qui ont affaire à de
jeunes enfants et qui n’étant pas spécialistes d’une discipline universitaire sont finalement des ignorants. La
pédagogie serait donc - comme l’orthographe - la science des ânes. On sait avec quelle force Durkheim, au
début du XXème siècle, combattait déjà ces propos en soulignant l’impérieuse nécessité de la pédagogie
pour le secondaire.
[18]
Cette explication des tribulations de l’IUFM, par la répétition bégayante de son ambiguïté principielle, s’avère à
ce point convaincante que la politique de droite en vient à la récupérer pour justifier les réformes actuelles.
Ainsi le rapport du député UMP Guy Geoffroy de 2007 peut-il reprendre à son compte l’analyse de Meirieu et
présenter la mastérisation de la formation des maîtres comme le dernier stade d’un processus destiné
précisément à éliminer l’ambiguïté constitutive de l’IUFM en donnant à la formation de tous les enseignants
« la véritable dimension universitaire, celle que connaissaient depuis longtemps les étudiants devenus professeurs du
2nd degré grâce aux remarquables formations assurées par nos facultés pour la préparation aux CAPES et à
l’agrégation »
[19]
. En lisant ces propos, on pourrait redouter au contraire que l’universitarisation ne soit ici qu’une
manière de retrouver le clivage historique du primaire et du secondaire (au profit du secondaire évidemment !)
que l’ambiguïté de l’IUFM s’efforçait en vain de surmonter. L’échec de la formation commune semble donner
raison aux critiques - quelles soient radicales ou réformistes - qui insistent sur la diversité des métiers de
l’enseignement. Sans que soit forcément remise en cause l’idée d’un corps unique d’enseignants, c’est bien
l’exigence de formations diversifiées qui se fait jour. La mastérisation ne va-t-elle pas alors redessiner l’espace
de la formation des enseignants en restaurant l’ancienne division : les professeurs du secondaire retrouvant le
chemin de l’Université qu’ils n’auraient jamais dû quitter et les professeurs d’Ecole restant à l’IUFM (ou ce qui
en tiendra lieu) ? A moins que d’autres partages plus subtils ne se dessinent entre filières universitaires
« nobles » (donc disciplinaires) auxquelles pourraient prétendre les stagiaires du second degré et filières
beaucoup moins prestigieuses (celles des sciences humaines) auxquelles devraient se cantonner les futurs
enseignants du primaire, les CPE…
Complications !
Quatre éléments obligent cependant à compliquer cette analyse fondée sur l’ambiguïté constitutive de l’IUFM.
D’abord, l’Université étant soumise à une injonction de professionnalisation, la critique radicale aura sans
doute de plus en plus de mal à y soustraire la formation des enseignants
[20]. Le rapport Caspar de 2002,
insistait sur la nécessité de former les formateurs dans cette optique [21]
. Le rapport Pochard de 2007, en
plaidant pour qu’on accorde plus de responsabilité et plus d’autonomie aux enseignants, en dénonçant le
taylorisme rémanent de l’institution, en proposant de rendre obligatoire la formation continue, paraît s’inscrire
dans ce mouvement
[22]
. Le rapport du Haut Conseil de l’Education de 2006 qui inspire la conception des futurs
masters de l’éducation, met en avant, de manière très explicite, le référentiel des dix compétences
professionnelles des enseignants. Il en est de même pour les tout récents rapports du « groupe inter-
conférences universitaires » et du rapport Marois de Juillet 2009 [23].
Reste à savoir si ceux des universitaires qui acceptent l’idée de professionnalisation en général sont prêts à accepter la professionnalisation du métier
d’enseignant. Comme le dit François Dubet, la professionnalisation des enseignants pose des problèmes
spécifiques car elle paraît séculariser une fonction sacrée (le professeur comme substitut du prêtre) qu’on ne
peut pas appréhender avec les catégories de la sociologie des professions.
L’autre élément positif provient des enquêtes sur les jeunes enseignants, qui les décrivent comme
pragmatiques, soucieux d’avantage d’efficacité dans le travail que d’options idéologiques (Rayou et Van
Zanten, 2004). Il se pourrait bien là aussi que la critique radicale ait du mal à se faire entendre et que les
jeunes enseignants s’avèrent davantage perméables à l’idée de formation professionnelle. Tout dépend – il
est vrai - de la façon dont cette exigence de professionnalisation sera interprétée : immersion plus ou moins
accompagnée dans la pratique ou promotion d’une dimension réflexive de et sur la pratique à l’instar de cette
« théorie-pratique » dont rêvait Durkheim.
La prise en compte de l’orientation libérale des politiques de réforme vient cependant altérer ce relatif
optimisme. Cette politique libérale, le discours réformiste la passe sous silence, la critique radicale la dénonce,
mais il se pourrait bien finalement qu’elle ait raison des uns et des autres et qu’elle ne rende dérisoire leurs
différences, voire leurs oppositions. En effet, la mastérisation des métiers de l’enseignement met sur le
marché une masse de main d’œuvre qualifiée et directement employable. Il suffirait donc de modifier les
règles de recrutement en confiant la responsabilité de l’embauche aux chefs d’établissement pour se
défausser sur eux du choix des meilleurs enseignants. Le pouvoir peut bien momentanément brandir
l’étendard des concours contre le laxisme présumé de l’IUFM et s’allier ainsi la critique radicale des néo-
républicains et des gardiens de la Culture, la logique libérale conduit inexorablement à réduire le rôle de ce
mode de sélection « bureaucratique » à défaut de pouvoir les supprimer brutalement. On est en France tout
de même ! Le pouvoir peut d’ailleurs s’éviter bien des ennuis en ne conservant qu’un concours de prestige,
l’agrégation. Il peut même se contenter de diminuer progressivement le nombre de postes à tous les concours
quels qu’ils soient, les vidant ainsi de leur sens, sans encourir d’opposition massive. L’alliance conjoncturelle
du pouvoir et de la critique radicale, sur le dos de l’IUFM, risque ainsi d’en décevoir plus d’un. On doute que
les néo-républicains, comme les gardiens de la Culture, ne s’y retrouvent ! Feront-ils assez confiance au
sérieux disciplinaire de l’Université pour faire leur deuil des concours ?
Toutefois, à ce jeu, la critique réformiste ne serait pas mieux lotie. Confier aux chefs d’établissement la
fonction de recrutement permettrait de minorer les enjeux de la formation professionnelle assurée par
l’Université, au profit d’un complément de formation post-universitaire par compagnonnage, la première année
de fonction. Le pouvoir pourrait ainsi se montrer progressivement plus laxiste envers l’Université et en rabattre
sur les contraintes imposées aux masters par la circulaire de 2008, tout en se ralliant l’idéologie populiste fort
répandue selon laquelle les formations et les sélections les plus exigeantes s’opèrent par l’épreuve des faits,
sur le terrain.
Quels rôles joueront alors les instances locales dans les débats et conflits qui ne manqueront pas de se
produire ? Car – et c’est le quatrième élément – la mastérisation de la formation des maîtres intervient dans
un contexte d’autonomisation des Universités. Bien des choses dépendront désormais des rapports de force
entre les ex IUFM, désormais Ecoles internes à l’Université, et les autres composantes de ces établissements.
Ces Ecoles internes se dilueront-elles complètement dans les départements universitaires ? Se réduiront-elles
à de simples « services communs » ? Seront-elles au contraire assez forte pour imposer l’idée de véritables
Facultés d’éducation ? Mais le diable est dans les détails et particulièrement ceux de l’organisation. Que
deviendra, dans les faits, cette l’ambition quelque peu exorbitante, de vouloir concilier, dans les futures
masters « métiers de « l’éducation », formation disciplinaire, initiation à la recherche et formation
professionnelle ? Comment éviter que cette dernière ne fasse les frais du déploiement des deux autres ? Et à
quels nouveaux compromis sommes nous voués ?
Conclusion
Situation paradoxale en effet que celle d’une volonté politique de suppression des IUFM, impuissante à
liquider son héritage et qui se voit obligée de composer avec son fantôme. Il arrive certes que les ministres
soient plus attentifs aux sirènes idéologiques qu’aux conclusions des rapports qu’ils commanditent. Mais, par
delà les outrances de la critique radicale, toujours plus virulente et plus médiatisée que jamais, on voudrait
espérer que le discours réformiste, porteur des exigences de professionnalisation de la formation des maîtres,
quoique plus souterrain, ne finisse par se faire entendre. Le risque est évidemment que la logique libérale qui
inspire les réformes, ne renvoie dos à dos et la critiques radicale et le discours des experts, les uns et les
autres apparaissant ainsi victimes d’un jeu de dupes. Le seul espoir serait-il dans un renversement des
alliances qui verrait la critique radicale et le discours expert unis dans la défense des concours contre les
excès du libéralisme ? Espoir bien fragile que celui de ce front de résistance exposé alors à de nouvelles et
improbables ambiguïtés.
Les contradictions entre discours radical et discours expert soumettent l’Université à des injonctions
paradoxales. Caution du sérieux disciplinaire de la formation des maîtres contre le prétendu pédagogisme des
IUFM, l’Université se voit également sommée de s’inscrire dans la logique de professionnalisation et de mettre
en œuvre le référentiel professionnel de l’IUFM. Pourtant l’Université n’est certainement pas prête - en tant
que telle et dans ces composantes traditionnelles - à opérationnaliser les exigences propres à la formation
professionnelle des enseignants, même quand elle en accepte le principe. Cette incapacité est à la fois un
risque et une chance pour l’IUFM. Si la dissolution de l’IUFM dans l’Université semble donner aux politiques
toutes les garanties d’une excellence scientifique – une fois n’est pas coutume ! - elle charge en revanche
l’Université d’une mission qu’elle ne peut accomplir sans recueillir, d’une manière ou d’une autre, l’héritage de
l’IUFM : son savoir faire propre qui est un savoir « incorporé » dans ses personnels permanents ou
occasionnels. Comme le souligne bien une récente étude (Danvers, 2008), « …malgré leurs manques parfois
vivement décriés, les IUFM restent la seule instance à avoir accumulé une expérience significative dans la formation des
enseignants, et rien ne justifierait de repartir de zéro ». Il se pourrait donc que, selon les mécanismes bien connus
de survie institutionnelle, le fantôme de l’IUFM ne hante longtemps les couloirs de l’Université, comme celui
des Ecoles Normales hantait – jadis et naguère ! – ceux de l’IUFM. Reste à savoir sous quelle forme
institutionnelle et organisationnelle. Esprit es-tu là ?
Références :
Altet, M., Paquay, L. et Perrenoud, Ph. (Eds.). Formateurs d’enseignants. Quelle professionnalisation ?
Bruxelles : De Boeck Université, 2002.
Altet M, La Formation professionnelle des enseignants, Paris, PUF, 1994.
Bourdoncle R. (1990). “ De l’instituteur à l’expert. Les IUFM et l’évolution des institutions de formation ”,
Recherche et formation, n°8.
Danvers C, Réformes des IUFM : vers une nouvelle professionnalité enseignante ?
L’Harmattan, 2009
Etienne, R., Altet, M., Lessard, Cl., Paquay, L., Perrenoud, Ph. L’université peut-elle vraiment former les
enseignants ? Bruxelles : de Boeck Université, 2009 (à paraître)
Fabre M, « Les controverses françaises sur l’école : La schizophrénie républicaine », in Enseigner et libérer
(direction Christiane Gohier), Les presses de l’Université de Laval, 2002
Fabre M, (2003), « L’Ecole peut-elle encore former l’esprit ? » In Revue Française de Pédagogie n° 143
Philosophie et éducation – Avril-Mai-Juin 2003
Gelin D, Rayou P, Ria L, (2008), Devenir enseignant : Parcours et Formation, Armand Colin.
Huberman, M (1989) La vie des enseignants. Évolution et bilan d’une profession
Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, 1989.
Robert A, Terral H, Les IUFM et la formation des enseignants aujourd’hui, Paris. PUF, 2000
Solère-Queval (1999) (dir) Les valeurs au risque de l’école, Presses universitaires du Septentrion.
Terral H. (1997), Profession : professeur. Des écoles normales maintenues aux Instituts universitaires de
formation des maîtres (1945-1990), PUF, Collection « Pédagogie d’aujourd’hui », 1997, 217 p.
Van Zanten A, Rayou P (2004), Changeront-ils l’école ? Enquête sur les nouveaux enseignants, Paris, Bayard.
[1] Recommandations pour la formation des Maitres, Haut Conseil de l’Education, 31 Octobre 2006.
[2] Le fer de lance étant la Société des Agrégés et son président G Bayet. On se souvient de son apostrophe devenue célèbre « Les professeurs
vont-ils cesser d’être des professeurs ? » interrogation reprise par un groupe d’intellectuels tel Régis Debray ou Robert Badinter (Terral et Robert,
2000, p. 85). Cette contestation sera relayée par beaucoup d’associations de spécialistes, au premier rang desquelles il faut compter l’association
des professeurs de philosophie refusant l’idée de « professionnalité globale » au nom des spécificités disciplinaires. Cette contestation a été
largement relayée par la presse.
[3] Pour un concentré des critiques, voir l’article « En finir avec les IUFM » de Fabrice Barthélémy et Antoine Calagué, Agrégés d’histoire,
enseignants en lycée et en collège, Cahiers pédagogiques] n° 411 - Février 2003. Voir également débat dans Le Monde du 02.09.02 .
[4] « La plupart des heures sont consacrées au "retour d’expérience", sorte de discussion à mi chemin entre la séance de thérapie
psychosociologique collective et les débats fréquemment pratiqués dans les débits de boissons ». In En finir avec les IUFM , op cit.
[5] « Quant aux cours de psychologie, sociologie et philosophie de l’éducation, ils n’ont qu’un rapport lointain avec les disciplines universitaires du
même nom. Leur faillite est double : ils sont à la fois dépourvus de tout intérêt et de toute application pratique pour de jeunes professionnels au
début de leur carrière, ce qui n’aurait guère d’importance s’ils n’étaient de plus très loin du niveau intellectuel qu’on serait en droit d’attendre d’un
institut "universitaire". Ibid.
[6] Brau-Antony Stéphane et Jourdain Christine. Evaluer la formation initiale des enseignants : enquête auprès des stagiaires. IUFM de Reims 2004
[7] Michael Huberman La vie des enseignants. Évolution et bilan d’une profession Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, 1989.
[8] Liste des rapports utilisés pour cette section : André Kaspi, Les IUFM au tournant de leur première décennie, panorama et perspectives, 1993 ;
CNE 2001, La formation initiale des professeurs et conseillers principaux d’éducation en deuxième année d’IUFM, Michel Bornancin, Janvier 2001.
La formation initiale et continue des maîtres, Février 2003, Georges Septours.
[9] « L’image d’ensemble des IUFM qui se dégage des évaluations conduites par le CNE dans vingt-deux d’entre eux est positive. Pour l’essentiel,
et dans un contexte souvent difficile, dont ce rapport fait état, les IUFM remplissent les missions pour lesquelles ils ont été créés. Les avis sur la
qualité des jeunes enseignants qui en sortent, recueillis auprès des inspecteurs et des chefs d’établissement rencontrés, sont convergents : ils sont
mieux préparés à leur métier qu’auparavant ».
[10] « Cette disposition a un coût certain mais elle permet aux recrutés de se consacrer entièrement à leur formation et elle ne retarde pas leur
entrée dans la carrière. » Le rapport envisage il est vrai des compensations financières : « La mission a en effet tenu compte dans sa réflexion des
probabilités d’allongement des durées de cotisation des fonctionnaires. » Les recommandations du Haut Conseil de l’éducation de 2006
reprendront l’idée d’un allongement (mais de quelques semaines seulement) de la formation de deuxième année.
[11] Il est en effet contre la culture commune et au-delà : « il faut rompre avec l’utopie simpliste d’un corps unique ». Il met l’accent sur la diversité
des métiers de l’enseignement en insistant sur les enseignements techniques, la maternelle. Il préconise la revalorisation de l’enseignement
disciplinaire : suppression de l’épreuve professionnelle au CAPES, réduction de la formation commune et générale au strict nécessaire. Il ramène
la pédagogie à la pratique et au terrain et le mémoire à un simple rapport de stage. Les enseignants de l’IUFM doivent être des enseignants en
exercice (pas de permanents, pas d’universitaires). Le « U » de IUFM est mis en question : pas de recherche à l’IUFM, pas de commissions de
spécialistes propres, tout au plus des conventions avec l’Université.
[12] C’est le cas pour les témoignages des stagiaires en notant que tel étudiant particulièrement critique dans un premier temps « revient entièrement
sur ses propos lorsque l’expert reformule son questionnement ». C’est le cas aussi pour tel témoignage d’inspecteur « le même inspecteur, qui
émet un certain nombre de réserves sur la formation dispensée à l’IUFM peut se montrer très élogieux sur les jeunes maîtres sortis de l’IUFM qu’il
a inspectés ».
[13] « Beaucoup de stagiaires sont déroutés ou réticents dès lors qu’on leur propose un type de formation qui fait appel à leur autonomie et à leur
capacité à trouver eux-mêmes des solutions, ou une activité qui exige d’eux un investissement personnel ». Ce décalage est certes révélateur de
la difficulté qu’éprouvent les formateurs « à faire partager leurs objectifs par les élèves, à justifier auprès d’eux les choix opérés en matière de
formation, voire à donner du sens à la formation ». C’est si vrai que des dispositifs qui – tels l’analyse de pratiques voire le « Groupes de
Référence, » comme dans l’IUFM de l’Académie des Pays de la Loire – tendraient précisément à combler le fossé entre théorie et pratique et à
responsabiliser les stagiaires, se heurtent à deux critiques d’ailleurs opposées : les stagiaires accusent le dispositif de les infantiliser, mais d’autre
part protestent si on ne leur propose pas de solution clé en main.
[14] « Il faut que le maître fasse sienne l’idée qu’à un moment donné son rapport antérieur aux savoirs académiques doit faire l’objet d’une véritable
transformation. C’est l’un des objectifs de sa formation professionnelle » et également que d’autres connaissances et savoir-faire sont aussi
nécessaires que ceux acquis dans le cadre de la formation académique. »
[15] Préface à l’ouvrage de Robert et Terral , Les IUFM et la formation des enseignants aujourd’hui, Paris, PUF, 2000.
[16] Philippe Meirieu, préface de l’ouvrage Les IUFM et la formation professionnelle des enseignants aujourd’hui André Robert, Hervé Terral,
Paris, PUF, 2000, pages 1 à 7).
[17] « Il y a tout d’abord un vieux préjugé français qui frappe d’une sorte de discrédit la pédagogie d’une manière générale. Elle apparaît comme un
mode très inférieur de spéculation. Par suite de je ne sais quelle contradiction, alors que les systèmes politiques nous intéressent, que nous les
discutons avec passion, les systèmes d’éducation nous laissent assez indifférents, ou même nous inspirent un éloignement instinctif. Il y a là une
bizarrerie de notre humeur nationale que je ne me charge pas d’expliquer. Je me borne à la constater ».
[18] Pour lui, c’était l’enseignement secondaire qui avait le plus besoin de pédagogie, parce qu’il était en crise, parce qu’il fallait repenser ce qui était
à enseigner et comment l’enseigner. La crise des lycées du début du XXème siècle questionnait en effet les trois schèmes de l’idéal éducatif de
l’école moderne : quelle nouvelle unité d’enseignement proposer ? Comment penser un nouveau curriculum ? Que peut vouloir dire aujourd’hui
former un esprit ? Qui ne voit que les questions que l’on se posait en 1904 sont encore les nôtres aujourd’hui ? (Fabre 2003).
[19] L’intégration des Instituts Universitaires de Formation des Maitres au sein des Universités. Des procédures en voie de conclusion aux
nécessités d’un véritable enracinement dans l’enseignement supérieur et la recherche. Guy Geoffroy, Député de Seine-et-Marne 2007
[20] Comme le dit avec force Antoine Prost, l’enseignement serait le seul secteur pour lequel la question de la professionnalisation ne se poserait
pas.
[21] Réflexion sur la formation des formateurs en IUFM, Pierre Caspar, 2002.
[22] Marcel Pochard, conseiller d’état. Livre vert sur le métier d’enseignant, La documentation Française, Janvier 2008.
[23] Rapport aux ministres de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, par William Marois, recteur de l’académie de
Bordeaux, le 17 Juillet 2009. et Contribution du groupe « inter-conférences universitaires » adressée à Madame la Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale : Principes et recommandations pour une réforme réussie de la formation des enseignants , 17 Juillet 2009.


