Accueil > Revue de presse > Travail : peut-on résister aux injonctions paradoxales sans péter un boulon ? (...)
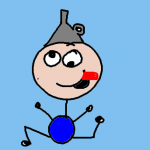 Travail : peut-on résister aux injonctions paradoxales sans péter un boulon ? - Marion Rousset, Télérama, 4 mai 2015
Travail : peut-on résister aux injonctions paradoxales sans péter un boulon ? - Marion Rousset, Télérama, 4 mai 2015
samedi 9 mai 2015, par
Dans un monde où marché et coachs en management font la loi, salariés et dirigeants sont submergés. Et le système se fissure de l’intérieur. Se soumettre ? Se démettre ? Comment concilier l’inconciliable ?
A lire sur le site de Télérama
« Soyons réalistes, demandons l’impossible. » Passé à la moulinette du management contemporain, le slogan fantaisiste de Mai 68 s’est trouvé propulsé de l’autre côté de la barricade. En catimini, il a atterri dans d’improbables cabinets de consultants chargés de standardiser les prescriptions de l’entreprise. Faire plus avec moins, avoir l’esprit collectif tout en se soumettant à des évaluations individuelles, renoncer à ses valeurs professionnelles pour mieux se réaliser, être libre de travailler en permanence grâce aux ordinateurs et aux téléphones portables…
Aujourd’hui, du cadre d’entreprise à l’employé administratif, de l’assistante sociale au salarié d’Orange, de l’infirmière à l’informaticien, tout le monde ou presque est sommé de concilier l’inconciliable. Au point que ces injonctions paradoxales pourraient bien finir par rendre tout le monde malade.
« Comment lutter contre ses pulsions schizoïdes et paranoïdes dans un contexte qui sollicite des comportements pervers ? », se demandent ainsi les sociologues Vincent de Gaulejac et Fabienne Hanique dans leur dernier essai, Le Capitalisme paradoxant. Fou, il y a de quoi le devenir. Les lieux de travail fourmillent d’équations inextricables à se taper la tête contre le bureau.
« Dans un centre d’appel d’une grande entreprise du secteur banque-assurance où nous avons enquêté, on demande au salarié de répondre très vite aux appels : le temps écoulé défile sur un bandeau. Et en même temps, il doit fournir un travail de qualité, répondre à fond à la question, donner satisfaction au client, alors qu’il n’a même pas accès aux dossiers », raconte par exemple la sociologue Dominique Méda. Fiabilité et rapidité, coût et sécurité, qualité de la relation client et productivité…
Le maniement du paradoxe
Révélé par des psychologues de l’école de Palo Alto, en Californie, le maniement du paradoxe, d’abord cantonné aux multinationales, a fini par s’immiscer partout, jusque dans les institutions publiques – à l’université ou à l’hôpital, dans la police ou la justice. « Cette situation, nous l’avions diagnostiquée à IBM dès les années 70 », précise Vincent de Gaulejac à propos de « l’autonomie contrôlée », notion aussi ancienne qu’usée à force d’avoir été pointée.
« On demande aux individus d’être des canards sauvages apprivoisés ! Ils doivent être créatifs tout en étant conformes à ce qu’on attend d’eux. » Ce mode de gestion né aux Etats-Unis s’est propagé en France dans les années 90, avant que le débat ne prenne récemment une tournure plus politique.
A l’heure des restrictions budgétaires, l’Etat lui-même impose à ses agents des orientations conçues par des « planneurs » mandatés pour produire des PowerPoint et raisonner en plans abstraits. Les nouveaux donneurs d’ordres, ce sont ces consultants extérieurs. Du coup, les conflits peinent à s’exprimer entre salariés et supérieurs hiérarchiques dans l’enceinte de l’entreprise.
« L’ambition managériale d’aujourd’hui est de créer une communauté dans laquelle tout le monde rame dans le même sens. Au sommet trône le marché, tandis qu’en bas on retrouve pêle-mêle les dirigeants, les cadres, les salariés de base qui sont tous dans le même bateau », analyse la sociologue Danièle Linhart. « Pour que chacun accepte de s’appliquer à soi-même ces prescriptions, il faut mener une action psychologique, en passer par une manipulation des subjectivités. »
Résultat, les tensions sont intériorisées. Et c’est tout un équilibre intime qui s’en trouve chamboulé. Sans compter qu’« on exige en plus une qualité totale, une satisfaction absolue, un projet d’amélioration infini… Or nul ne peut être dans le zéro défaut. Prise au sérieux, la somme de ces prescriptions idéales fabrique un monde impossible, ajoute la sociologue Marie-Anne Dujarier. Les gens ne se sentent jamais à la hauteur. »
Big bang managérial
Mis au défi de s’adapter à des demandes insoutenables, chacun cherche cahin-caha à ne pas y laisser trop de plumes. Quelles ressources déployer pour désamorcer les effets dévastateurs de ce big bang managérial ?
Option numéro un : développer des mécanismes de défense pour ne pas virer dingue. Enfermer ses doutes dans les profondeurs de son inconscient, ne plus penser par soi-même, rationaliser, se noyer dans le travail, refouler son moi et faire « comme si »… Quand une partie de soi accepte de se couler dans le moule tandis que l’autre se cache pour ne pas se laisser capter, « les psys parlent de personnalités "as if". Ce symptôme de psychopathologie est aujourd’hui devenu un phénomène social », avance Vincent de Gaulejac.
C’est en tout cas un jeu risqué qui peut même déboucher, dans les cas extrêmes, sur un sentiment de schizophrénie. Pas vraiment satisfaisant, donc, quoique moins coûteux à court terme qu’une résistance qui mobilise une énergie de tous les instants…
Option numéro deux : résister activement. Pour ne pas se laisser piéger, il faut pouvoir mettre à distance la violence institutionnelle par l’humour ou la dénonciation. Rire entre collègues de sa « médaille en chocolat », de « chiffres hystériques » ou d’« évaluation au doigt mouillé ». Désinvestir psychiquement le travail ou réinvestir des métiers qui font sens. Vénérer la lenteur plutôt que la vitesse, préférer la tranquillité au mouvement, renoncer à vouloir se dépasser…
Héros obscurs
« Tous les jours, des individus résistent à cette mise en tension. Ces héros obscurs refusent la course narcissique à la performance et à la reconnaissance, ils inventent d’autres modes d’existence, entre petits boulots et marginalités installées. Mais ces réactions restent encore invisibles », souligne Vincent de Gaulejac.
L’espèce humaine n’a donc pas dit son dernier mot. Malheureusement, le bricolage individuel a ses limites. Il s’attaque aux symptômes mais ne soigne pas le mal à la racine. « La souffrance et la paranoïa viennent du fait que les gens ont l’impression d’être les seuls à subir pareilles difficultés. Il est pourtant peu probable de devenir collectivement fous ! » affirme Danièle Linhart.
Les salariés le savent… et le formulent. « Quand vous les interrogez, tous disent qu’ils ne demandent que ça, un espace pour discuter sérieusement de leur travail avec un supérieur hiérarchique. Un moment pas seulement destiné à les évaluer, mais qui leur permette d’aborder les difficultés qu’ils rencontrent… »
C’était l’ambition des lois Auroux. Promulguées en 1982, elles espéraient donner le jour à des groupes d’expression. Raté. Il faut dire qu’à l’époque peu de monde en voulait. Les syndicats estimaient que c’était de leur ressort sans pour autant s’y coller, et les salariés étaient encore réticents à parler d’eux, de leur souffrance, dans le cadre du boulot. Un boulevard pour le patronat, qui a transformé ces espaces en « cercles de qualité » : importée du Japon dans les années 80, l’idée était de réunir une poignée de salariés à intervalles réguliers pour souder les équipes, améliorer la communication et le savoir-faire…
Quarante ans plus tard, il est devenu impossible d’ignorer les failles d’un modèle qui se fissure de l’intérieur. Alors les entreprises ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Confrontées au risque de burn-out, elles raffolent des grandes messes concoctées par des coachs en management, lesquels se targuent d’« humaniser » la gestion grâce à des séances de méditation parfois collectives. Elles organisent des dîners en silence ou des séminaires de réflexion afin d’insuffler à leur personnel confiance en soi, maîtrise émotionnelle, optimisme, compassion et bienveillance.
Solution miracle, la mindfulness (pleine conscience) séduit toujours plus de dirigeants. A commencer par ceux de Google, qui ont lancé le mouvement avec leur programme baptisé « Search inside yourself » et se félicitent, par ailleurs, d’autoriser leurs ingénieurs à consacrer 20 % de leur temps à des projets personnels.
Siphonner le potentiel critique
Seulement voilà, comme les cercles de qualité, ces méthodes ne se lassent pas de faire miroiter une amélioration des performances et de la productivité. C’est la force du capitalisme, cette plasticité qui le rend capable de siphonner à la base le potentiel critique de certaines idées. Et de créer des outils sans cesse réajustés à un but qui, lui, reste inchangé.
« Créer des lieux d’échange véritable ne peut avoir de sens que si l’initiative part des individus eux-mêmes, estime Danièle Linhart. Ces derniers pourraient déployer leurs compétences et leur expérience pour contribuer à inventer de nouvelles organisations du travail qui ne les rendent pas malades. » En attendant, certains prennent les devants, comme ce postier qui, après avoir assisté aux séminaires de Vincent de Gaulejac, a décidé de monter un groupe informel d’histoires de vie professionnelle à l’heure du déjeuner.
A Radio France, c’est le personnel qui a sollicité le chercheur : « Les salariés ont beaucoup protesté contre le fait que les réformes avaient été conçues à l’extérieur, raison pour laquelle ils sont si remontés contre Mathieu Gallet, qui vient des cabinets ministériels. Au-delà du sauve-qui-peut généralisé, ils essaient d’inventer des espaces de délibération », observe Vincent de Gaulejac. La preuve que les mentalités commencent à évoluer…
En espérant qu’un jour ces innovations finissent par convaincre un personnel politique focalisé sur la croissance, obnubilé par les prochaines élections, handicapé par sa flagrante inexpérience du monde du travail et dépourvu d’imagination. Aujourd’hui, c’est sur le terrain que tentent de s’inventer les formes d’organisation de demain. Le changement, c’est ici et maintenant. Mais, hélas, sans les responsables politiques.
A lire
Le Capitalisme paradoxant. Un système qui rend fou, Vincent de Gaulejac et Fabienne Hanique, éd. du Seuil, 288 p., 21 €.
Le Management désincarné. Enquête sur les nouveaux cadres du travail, Marie-Anne Dujarier, éd. La Découverte, 250 p., 18,50 €, à paraître le 15 mai.
La Comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Danièle Linhart, éd. Erès, 158 p., 19 €.
Travailler au XXIe siècle. Des salariés en quête de reconnaissance, Dominique Méda (codir.), éd. Robert Laffont, 324 p., 20 €.


